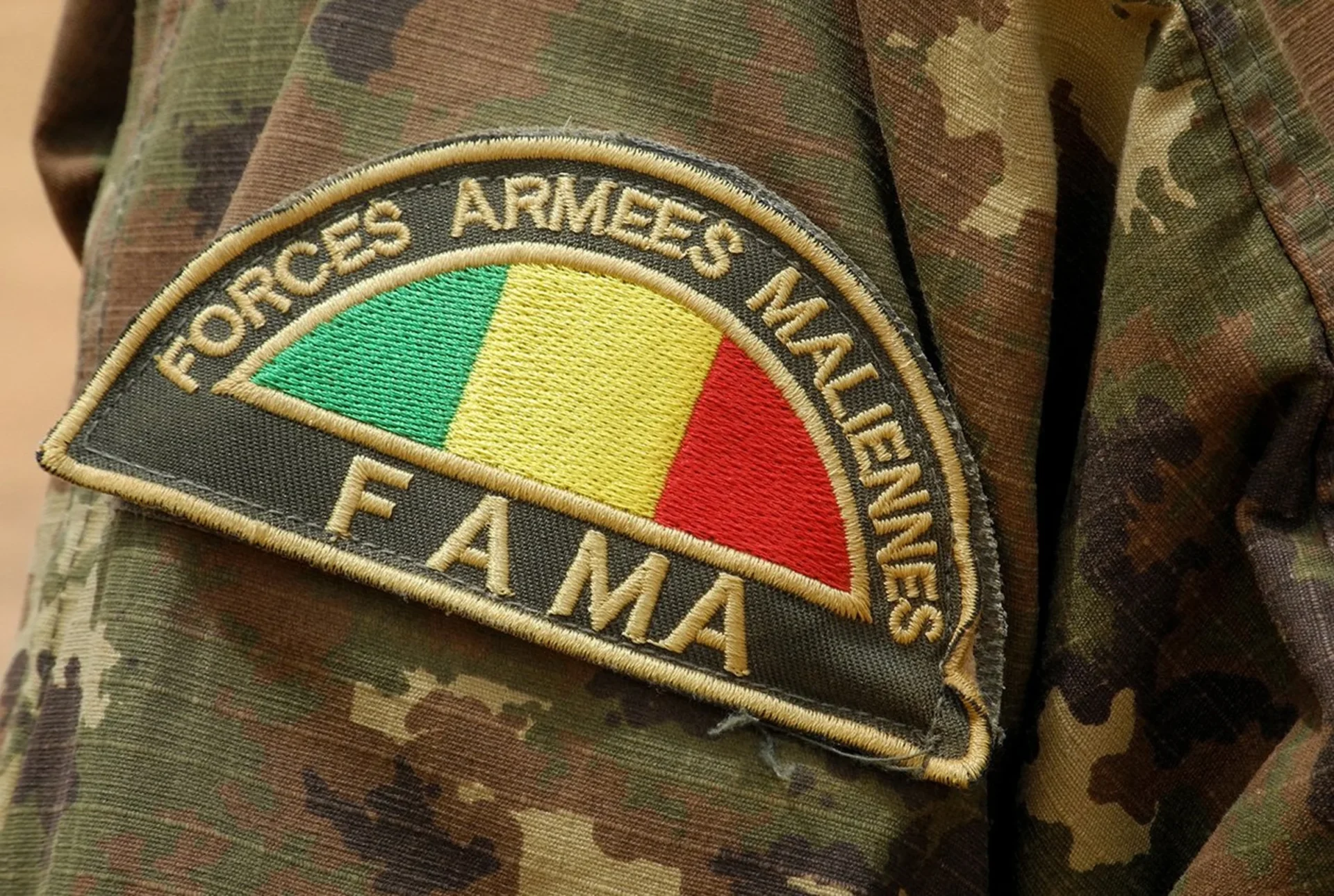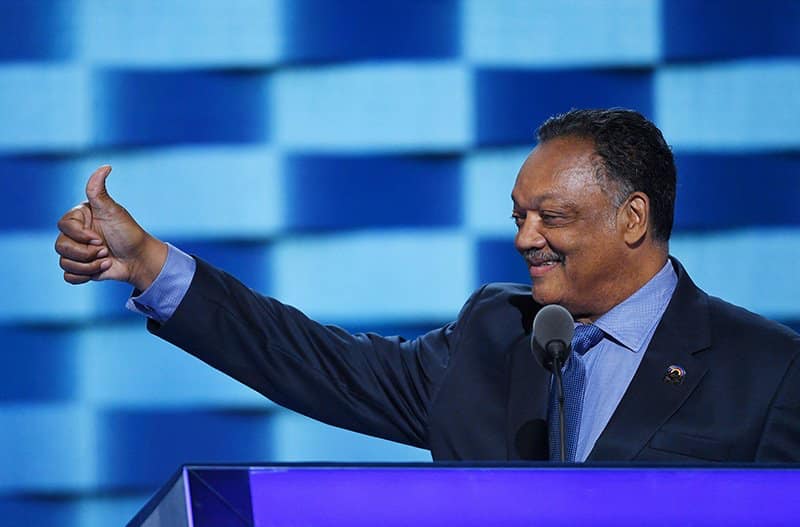Aujourd’hui, le Mali traverse l’une des épreuves les plus sombres de son histoire contemporaine. Ce que nous vivons n’est pas une guerre conventionnelle, mais une guerre asymétrique, insidieuse, brutale, imprévisible. Une guerre qui ne se contente pas de prendre des vies, mais qui s’attaque à l’âme même de notre nation.
Et si elle perdure, c’est aussi parce qu’elle trouve un terrain fertile dans notre passivité, dans notre indifférence, et, parfois, dans la complicité silencieuse de certains parmi nous.
Une guerre qui se nourrit du silence
Contrairement à ce que certains voudraient croire, cette guerre ne se mène pas seulement avec des armes. Elle se joue aussi dans les non-dits, dans les regards détournés, dans les vérités que l’on choisit d’étouffer.
– Tourner la tête, c’est accepter l’inacceptable
– Fermer les yeux, c’est tolérer l’intolérable
– Se taire, c’est être complice de la barbarie.
Le mal ne gagne pas toujours parce qu’il est plus fort. Parfois, il suffit que les gens bien se taisent pour qu’il triomphe.
Une menace pour notre avenir commun
La situation actuelle n’épargne personne. Elle freine le développement économique de notre pays, désespère notre jeunesse, affaiblit nos institutions, et met en péril l’unité nationale.
Le Mali ne peut pas avancer si une partie de son territoire vit dans la peur.
Le Mali ne peut pas espérer un avenir stable si ses enfants ne vont plus à l’école, si ses forces de défense luttent seules, et si ses citoyens ferment les yeux.
Et pourtant, peu de nations au monde portent en elles une richesse humaine et culturelle aussi forte que le Mali : hospitalité, dignité, solidarité. Ces valeurs font partie de notre identité profonde. Elles sont notre plus grande force, mais elles sont en train de s’éteindre sous le poids de la peur, de la lassitude et de l’indifférence.
Retrouver l’élan national
Nous n’avons plus le droit de rester spectateurs. Il est temps de comprendre que la sécurité est l’affaire de tous. Que chaque citoyen, chaque village, chaque famille a un rôle à jouer.
Ce sont les petits gestes quotidiens, les prises de position courageuses, les actes de solidarité concrets qui, mis bout à bout, changent le cours des choses. Ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières.
Soutenir nos forces, c’est se défendre soi-même
Nos forces de défense et de sécurité, souvent sous-équipées, parfois isolées, mais toujours debout, méritent plus que notre admiration ; elles méritent notre appui actif.
Elles défendent nos terres, nos vies, nos valeurs. Elles sont infatigables, foncièrement impliquées, et déterminées à protéger la nation.
Mais elles ne peuvent pas gagner seules. C’est à nous, citoyens, de former la seconde ligne. Par la vigilance. Par la dénonciation de toute complicité. Par le refus catégorique de la haine et de la désinformation. Par l’éducation, la cohésion, l’entraide.
Redevenir une nation debout
Ce pays est le nôtre. Et nous sommes encore capables de nous relever, ensemble.
Il est temps de retrouver l’amour du Mali, de nous regarder comme des frères, et non comme des ennemis potentiels. Le patriotisme ne se limite pas aux discours, il se prouve dans l’engagement, dans le refus de la peur, dans la solidarité active.
La guerre ne se gagnera pas sans nous. Et si nous voulons que le Mali vive, il faut que chacun d’entre nous choisisse de se lever.
Texte collectif