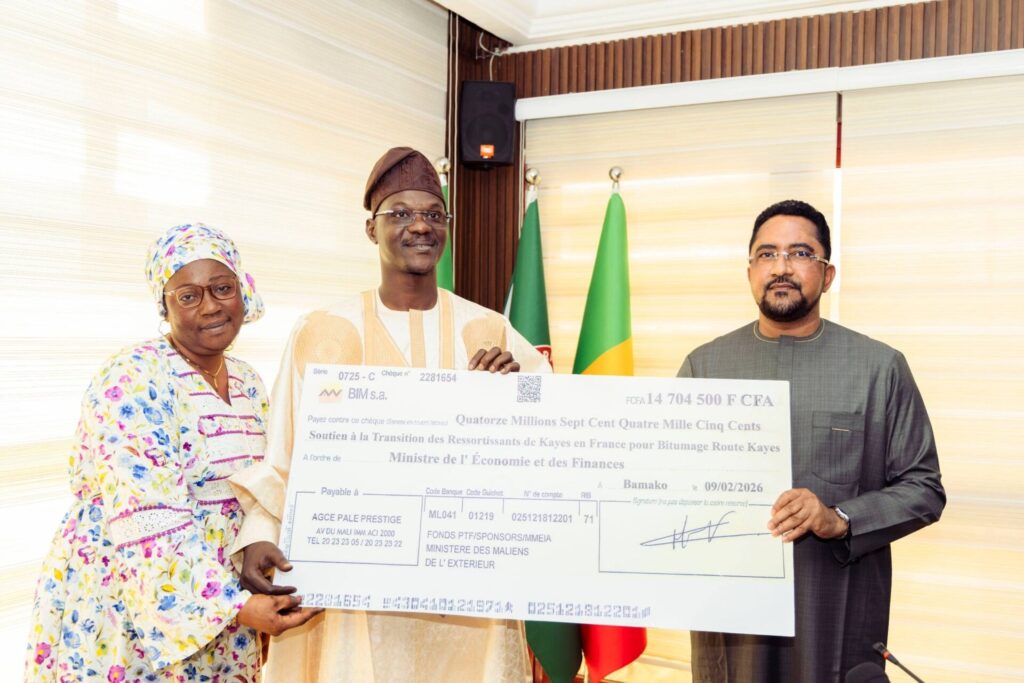Bamako, 9 octobre 2025. Un coup de tonnerre dans le paysage éducatif malien : le ministère de l’Éducation nationale annonce la suspension immédiate de l’enseignement de la Révolution française en classe de 9ᵉ année. Ce n’est pas une simple réforme de programme. C’est un acte politique, un geste fort, un tournant historique. Le Mali ne veut plus apprendre l’Histoire des autres avant la sienne.
Pendant trop longtemps, les bancs des écoles maliennes ont résonné au son de « liberté, égalité, fraternité », sans jamais faire écho aux voix de Soundiata Keïta, d’Aoua Keïta, de Samory Touré ou de Kamadjan Camara. On enseignait Robespierre, mais pas assez Amadou Hampâté Bâ. On récitait les grands principes de la Révolution française, sans jamais interroger leur absence dans la trajectoire de l’Afrique.
Où étaient l’égalité et la liberté lorsque les peuples africains étaient réduits en esclavage ?
Où était la fraternité quand les colonisateurs pillaient les terres, effaçaient les langues et écrasaient les cultures ?
Où est la justice quand l’école oublie d’enseigner à ses enfants leur propre histoire ?
Cette décision du Mali n’est pas un rejet de la culture générale. C’est une reconquête de la mémoire, de la dignité, et du droit de choisir les récits qui forment les consciences.
Elle incarne une triple affirmation de souveraineté :
– Une justice éducative : mettre fin à un enseignement déconnecté des réalités, qui forme des jeunes ignorants de leur propre héritage.
– Une affirmation identitaire : sortir du moule eurocentré pour faire place aux civilisations, aux luttes et aux victoires africaines.
– Un appel à la conscience collective : car comment prétendre bâtir un avenir quand on ne connaît pas son passé ?
Le débat fait rage, mettant en lumière un mal plus profond, une jeunesse qui cherche ses repères, nourrie de récits qui ne lui ressemblent pas. Ce n’est pas un repli sur soi. C’est un recentrage. Il ne s’agit pas de tourner le dos au monde, mais de cesser de se contempler à travers les yeux de l’Occident.
À ceux qui crient à la censure ou au repli identitaire, une seule question : Pouvez-vous citer deux grandes figures de la résistance africaine à la colonisation en dehors du Mali ? Si la réponse est non, alors la réforme est non seulement légitime, mais surtout vitale.
Comme le dit un proverbe malien : « le séjour dans l’eau ne transforme pas un tronc d’arbre en crocodile. »
L’Afrique n’a pas à se calquer sur l’Europe. Elle a ses héros, ses combats, ses valeurs, sa grandeur. Et c’est à l’école que commence cette réappropriation.
Il est temps de le dire haut et fort, la souveraineté ne se résume pas à ce qui est inscrit dans les constitutions. Elle se grave dans les esprits, s’imprime dans les livres, s’ancre dans les récits et se manifeste dans les comportements.
Elle respire dans chaque salle de classe, vibre dans chaque mot transmis, grandit dans chaque enfant qui, enfin, apprend à s’aimer sans complexe, à se connaître sans détour, à se tenir debout avec fierté, enraciné dans son histoire et résolument tourné vers l’avenir.
Manda CISSE