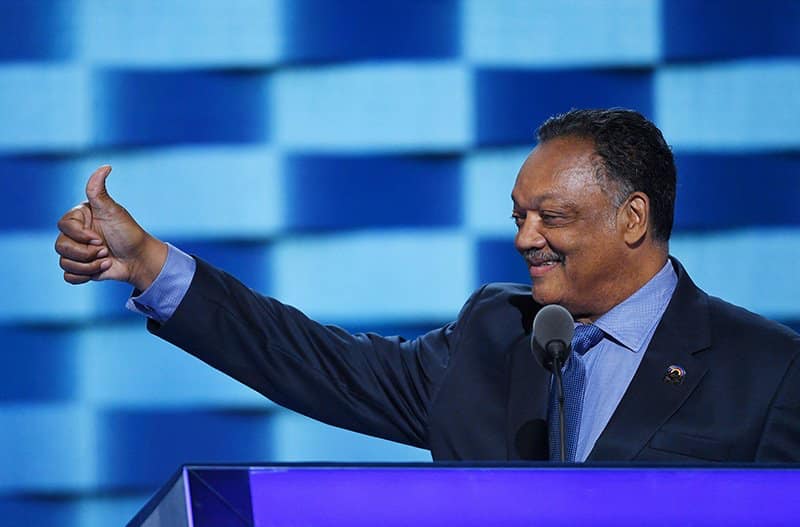« Honneur à nos devanciers, modèles de courage et de vertu, et confiance en la jeunesse pour continuer leur œuvre. »
L’âge, la mémoire et l’espérance
Nous, le Mali et moi, sommes nés la même année : 1960.
Mais c’est moi l’aîné !
J’ai déjà franchi mes 65 ans, tandis que mon pays, le Mali, s’apprête à atteindre ce cap symbolique.
Le 22 septembre 1960, à Bamako, dans la grande salle du Collège Technique, aujourd’hui Lycée Technique, se tenait le Congrès extraordinaire de l’US-RDA.
Ce fut l’acte fondateur de notre souveraineté.
Ce jour-là, Modibo Keïta, secrétaire général de l’Union Soudanaise RDA et futur premier président de la République, proclama l’indépendance de notre pays, mettant fin à la Fédération du Mali avec le Sénégal.
Depuis, deux destins se croisent : celui d’un homme et celui d’une nation, faits d’enthousiasmes et de blessures, de rêves parfois trahis et de fidélités tenaces.
L’âge enseigne la patience et la mémoire.
J’ai vu, vécu, appris.
Mon pays aussi a connu des élans d’espérance et des traversées sombres, mais toujours il s’est relevé, porté par la force de ses enfants.
À 65 ans, un homme ne devrait pas renier son passé, ni se réfugier dans la nostalgie.
Il devrait transformer ses cicatrices en force et préparer le chemin de ceux qui viennent après lui.
À 65 ans, une nation ne devrait pas non plus répéter ses erreurs, ni oublier les sacrifices de ses martyrs.
Elle devrait rester fidèle aux idéaux de ses fondateurs et donner toute sa place à sa jeunesse.
Vieillir dignement, pour un pays comme pour un homme, c’est savoir faire de ses épreuves une source de force.
De 1960 à 2025, j’ai grandi avec mon cadet : parfois en avance, parfois en décalage, toujours en fraternité.
Si j’ai pu transformer mes blessures en ressources intimes, je formule le vœu que mon pays, à 65 ans, transforme à son tour ses épreuves en un socle d’espérance.
Car une nation, comme un homme, ne se juge pas seulement à ce qu’elle a traversé, mais à ce qu’elle transmet à ceux qui viendront.
Fragments d’enfance et de jeunesse
Je me souviens des ferveurs collectives, de ces investissements humains qui rendaient Bamako propre avant les fêtes, des retraites aux flambeaux et des feux de camp illuminant nos nuits d’enfants à la veille du 22 septembre.
Ces gestes simples, empreints de solidarité et de joie, gravaient dans nos mémoires le sens de la fête nationale : fraternité, espérance et responsabilité.
Je me souviens aussi de ce jeune garçon venant de son Beledougou natal, qui travaillait chez mes parents à Korofina.
Ce matin-là, il avait fait son ménage aux aurores et, tout fier dans ses habits de fête, s’apprêtait à aller assister au défilé militaire.
Maman lui dit en souriant qu’elle lui gardait son repas au chaud.
Mais il répondit avec une candeur lumineuse :
« Comment peut-on fêter le 22 septembre sans donner à manger à tout le monde ? »
Comme les commandants de cercle à l’époque le faisaient !
Par cette parole simple, il rappelait que la fête nationale n’était pas seulement affaire de drapeaux et de défilés, mais aussi de partage et de justice, vécus comme des évidences dans le cœur des plus modestes.
Et puis il y a ces années passées à l’école publique, gratuite, où l’on remboursait une modeste « masse de garantie » en francs maliens quand les livres étaient rendus en bon état.
Pour nos parents, c’était la fierté d’un Mali qui se construisait, rempli d’idéaux.
Nous balayions à tour de rôle nos classes et la devanture, apprenant discipline et solidarité.
À l’époque, « Monsieur » ne s’appelait pas « Mechié » ; il était un maître exemplaire, sans reproche, qui faisait honneur à sa mission.
Ces images d’école et de cité, simples et exigeantes, sont restées gravées en moi : la gratuité, le respect des biens communs, la discipline partagée, l’exemplarité de nos maîtres.
Elles disent beaucoup de ce que nous étions capables de bâtir quand l’idéal collectif guidait nos pas.
Le creuset de Badalabougou
Après l’obtention du Diplôme d’études fondamentales, s’ouvrit pour nous en 1975 une étape décisive : l’internat du lycée de Badalabougou.
Ce fut la rencontre avec la jeunesse de tout un pays. Nous venions des quatre points du Mali, porteurs de nos langues, de nos traditions et de nos confessions diverses, et pourtant appelés à partager un même quotidien.
Les dortoirs étaient nos foyers communs.
Nous dormions côte à côte, mangions au réfectoire matin, midi et soir les mêmes repas, portions les mêmes habits et les mêmes chaussures.
Dans cette égalité imposée par la vie collective, se forgeait une fraternité profonde, celle d’une génération qui faisait l’expérience intime de la nation.
Nos enseignants venaient du monde entier : soviétiques, français, chinois, américains, maliens.
Chacun d’eux, à sa manière, nous offrait une parcelle de savoir et une ouverture sur l’universel.
Mais la leçon la plus précieuse, nous la tirions de nous-mêmes : vivre ensemble, apprendre ensemble, grandir ensemble.
Ces trois années partagées à Badalabougou demeurent gravées comme un creuset.
Là s’est façonné le sentiment d’appartenance à une seule et même patrie, au-delà des différences et des clivages.
Là s’est enracinée l’idée que, malgré nos singularités, nous étions appelés à marcher sous un même ciel, à bâtir un même avenir.
Aujourd’hui encore, en replongeant dans la mémoire de ces années d’internat, je retrouve l’évidence première : le Mali est cette maison commune où l’on apprend, dès l’adolescence, que l’unité est une richesse et que la fraternité est une force.
Passions et promesses
Côté passion football, j’attends toujours cette coupe depuis les Jeux de Brazza, puis Yaoundé 1972, et plus tard la CAN 2002.
Les résultats positifs du basket compensent parfois, mais les aficionados du football sont légion.
À 65 ans, je mesure combien ces héritages croisés, ceux d’un homme et ceux d’une nation, doivent continuer d’inspirer nos choix.
Car l’avenir du Mali ne se jouera pas seulement dans les bilans du passé, mais dans la capacité à transmettre aux générations nouvelles la rigueur, la dignité et l’espérance qui nous ont fait grandir.
C’est là, dans la fidélité à nos racines et dans la confiance en notre jeunesse, que se trouve la véritable promesse de notre indépendance.
Bamako, le 10 septembre 2025
Par Ibrahima Abdoul LY