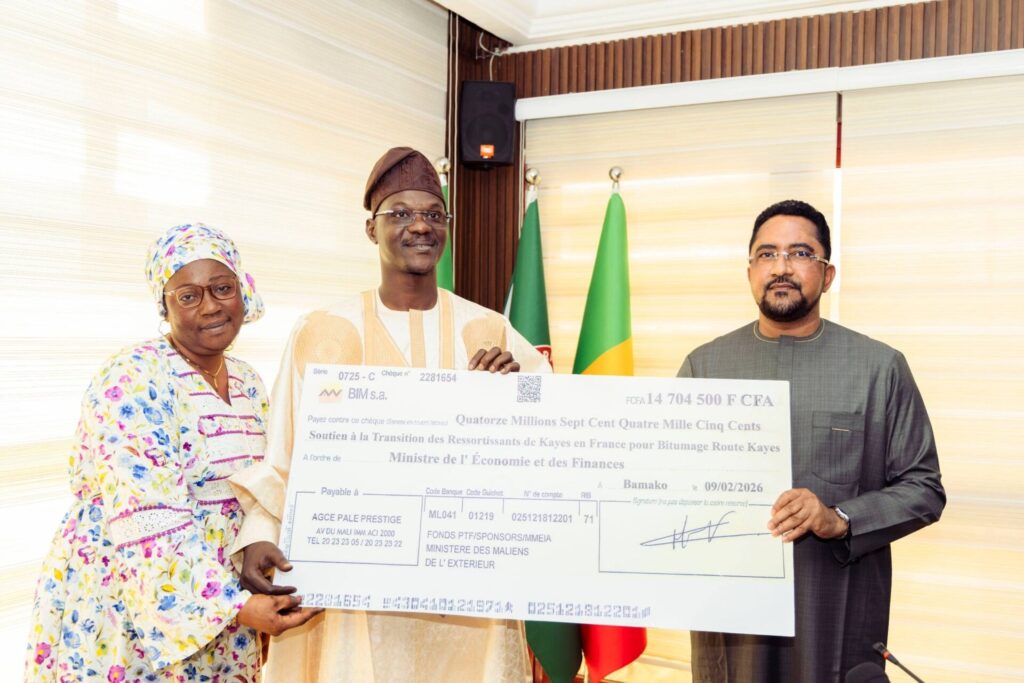François Hollande refait surface. Une nouvelle fois, il se permet de commenter la situation malienne, d’évoquer Wagner, la Russie, la junte, comme si son avis faisait encore autorité. Comme si le Mali était resté bloqué au temps où Paris dictait la marche à suivre. Comme si les Maliens attendaient encore son approbation. Le décalage est saisissant. L’Afrique avance, mais Hollande continue de parler depuis un monde qui n’existe plus.
Disons-le sans détour, François Hollande n’a aucune légitimité pour donner des leçons au Mali.
Il suffit de rappeler son propre héritage. Pendant plus de dix ans, la présence militaire française au Mali, qu’il a initiée, n’a produit aucun résultat durable. Les opérations Serval puis Barkhane ont mobilisé des moyens colossaux, sans parvenir à stopper l’avancée du terrorisme. L’insécurité s’est étendue, les groupes armés se sont multipliés, des régions entières se sont fracturées et Kidal totalement perdu. Au final, la France a été priée de partir par les autorités maliennes, lassées de promesses sans solutions.
Voilà la réalité que François Hollande oublie commodément lorsqu’il parle du Mali aujourd’hui.
Il oublie aussi l’histoire longue, celle qui dérange. La France n’est pas un acteur neutre dans cette région. Elle est une ancienne puissance coloniale, présente au Mali depuis la conquête de 1880 jusqu’à l’indépendance de 1960, puis omniprésente dans la vie politique, militaire et économique du pays pendant encore plusieurs décennies. Près de cent quarante ans de présence directe ou d’influence étroite ont profondément marqué le pays. Les lignes de fracture actuelles, les tensions, les déséquilibres territoriaux, les crises politiques ne sont pas apparues en 2012 ni avec l’arrivée supposée de Wagner. Ils s’inscrivent dans un héritage colonial que la France n’a jamais véritablement assumé ni réparé.
Pourtant, Hollande préfère pointer du doigt Wagner. Il parle de menace, de déstabilisation, de néocolonialisme russe. Le problème, c’est que cette présence reste entourée d’incertitudes, faute de transparence, alors que l’échec militaire français, lui, est parfaitement documenté. L’obsession autour de Wagner sert avant tout à masquer le fiasco français, et à réécrire l’histoire d’une intervention qui s’est soldée par un rejet massif de la population malienne.
Le discours français sur le Mali souffre toujours du même travers : un paternalisme enraciné. À Paris, on continue de parler au Mali comme à un élève qui aurait mal travaillé. On sermonne, on corrige, on explique ce que le pays « devrait » faire, comme si l’époque coloniale n’était jamais vraiment terminée. Mais cette posture ne passe plus. Le Mali a changé de cap, et plus largement, l’Afrique refuse désormais ce ton condescendant qui vient d’un autre siècle.
Quant à François Hollande, son autorité morale est inexistante à Bamako. Son quinquennat reste associé à des choix stratégiques hasardeux, à des interventions mal planifiées, à une relation franco-malienne qui s’est dégradée irréversiblement, et à un Sahel laissé dans une situation encore plus instable qu’avant son arrivée au pouvoir. Son héritage diplomatique est mince, et son influence politique en France même est aujourd’hui quasiment nulle.
Alors qu’aurait-il à enseigner au Mali ? Rien. Absolument rien.
Le Mali n’a pas besoin d’approbation. Il n’a pas besoin de bénédiction. Il fait ses choix, assume ses alliances et avance selon sa propre vision. La période où Bamako devait se justifier devant Paris est bel et bien révolue. Le Mali n’écoute plus les sermons, il trace sa route.
François Hollande ferait donc mieux de comprendre une chose simple : son avis sur le Mali n’a plus aucune valeur stratégique, politique ou morale. Le Mali regarde vers l’avenir, pas vers les fantômes d’une influence française en déclin.
Manda CISSE