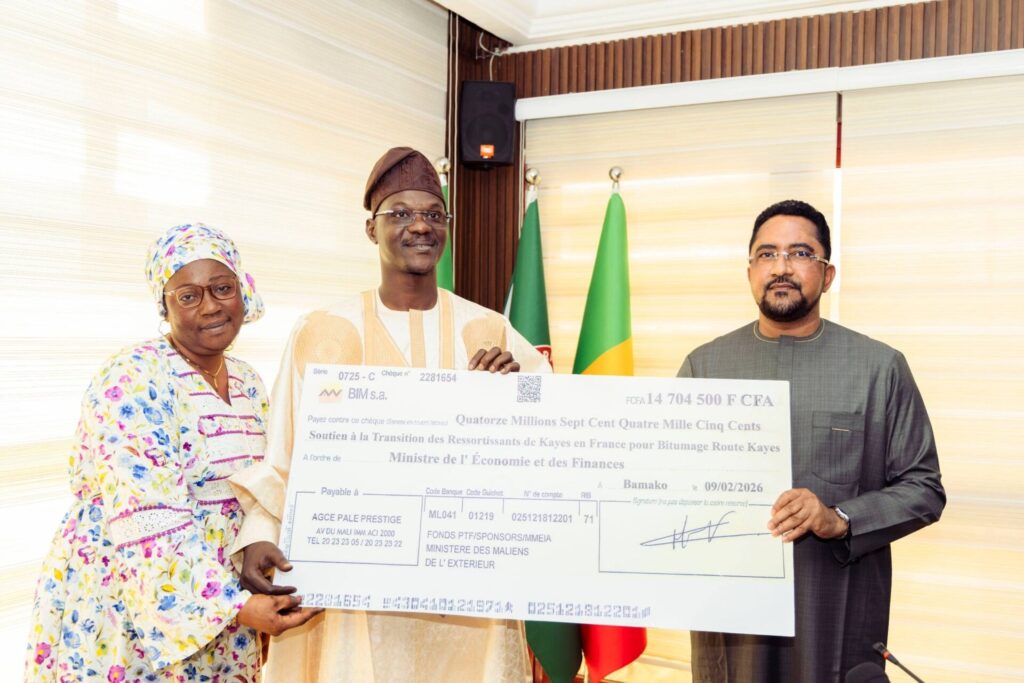13 novembre 2025, à Libreville, sous le soleil de la Baie des Rois, diplomates, policiers et responsables gabonais se réunissent pour une cérémonie officielle. L’ambassade de France remet cinq vélos tout-terrain à la police nationale, présentés comme un renforcement de la sécurité publique et de la mobilité des patrouilles.
Cinq vélos. Cinq.
Pour cela, on déploie un protocole, on prononce des discours, on prend des photos. Et pendant ce temps-là, on voudrait nous faire croire qu’il s’agit d’un acte de coopération digne, équilibré et respectueux. Mais non, ce geste est méprisant. Il en dit plus sur la perception de certains États africains que n’importe quel discours officiel.
Un mépris qui ne se cache même plus
Dans un monde où les enjeux sécuritaires sont complexes, où les États modernes investissent dans la technologie, la formation, l’équipement robuste, la France juge acceptable d’offrir… des vélos. Non pas des véhicules d’intervention, non pas des équipements tactiques, non pas un appui structurel. Des vélos.
L’ironie est mordante : un pays qui s’endette pour livrer des Rafale, des missiles, des technologies sensibles à d’autres partenaires que nous ne citerons pas ici, offre à un État africain ce que certaines municipalités françaises n’oseraient même plus offrir à leurs brigades locales.
Ce n’est pas un détail, ce n’est pas une maladresse, c’est un signal clair de hiérarchisation. Certains partenaires valent des milliards, d’autres des bicyclettes.
Une humiliation officialisée, ritualisée, photographiée
Le scandale n’est pas seulement dans le don. Il est dans la mise en scène.
Organiser une cérémonie officielle pour cinq vélos en 2025 est une humiliation publique. Et pourtant, elle est acceptée, validée, mise en avant. Preuve d’un rapport de dépendance que rien, absolument rien, ne justifie.
Une police nationale digne ne parade pas pour quelques vélos. Un État souverain ne transforme pas une aumône logistique en événement diplomatique.
Cette cérémonie ne reflète pas une coopération, mais une capitulation symbolique.
Un miroir brutal de la considération accordée à l’Afrique
Ce don n’est pas neutre, il révèle un traitement différencié, presque institutionnalisé.
- certains partenaires stratégiques : armements de pointe, contrats, coopération lourde.
- Aux pays africains : de la communication, du symbolique, du léger, du superficiel.
Refuser de le voir, c’est refuser de comprendre comment les alliances se structurent réellement. Elles se structurent par intérêt, par hiérarchie, par calcul. Et dans cette hiérarchie, le Gabon est traité comme un pays que l’on peut satisfaire avec cinq vélos.
Une responsabilité partagée : le mépris ne prospère que là où il est accepté
Dire que la France méprise est une chose. Mais la manière dont le Gabon accepte ce mépris en est une autre.
On ne peut pas reprocher à un partenaire de manquer de considération lorsque l’on se contente soi-même de si peu.
Accepter, célébrer et afficher cette remise, c’est entériner sa propre dévalorisation. C’est passer un message clair au monde : « nous nous satisfaisons de ce que les autres ne veulent plus ».
Un État respecté est un État qui exige le respect.
Un État qui ne se respecte pas s’expose inévitablement à l’humiliation et à l’insignifiance.
Il est temps d’exiger une coopération adulte
La coopération internationale ne doit pas être un théâtre paternaliste. Elle doit être :
- stratégique,
- équilibrée,
- mutuellement bénéfique,
- et respectueuse.
Des dons symboliques n’y ont pas leur place. Des gestes humiliants encore moins.
La France sait très bien fournir du matériel sérieux lorsqu’elle le juge nécessaire. Si elle ne le fait pas ici, ce n’est pas par incapacité, mais par choix.
Et tant que les États concernés accepteront des miettes en se drapant dans des cérémonies officielles, le mépris s’installera, se répétera, s’ancrera comme ici à Libreville.
Cette date restera comme l’illustration d’un rapport de force déséquilibré, d’un manque de considération assumé et d’une acceptation passive de l’humiliation.
Cinq vélos ne changeront pas la sécurité publique du Gabon. Mais ils auront révélé une réalité plus profonde : le degré de respect qu’un État reçoit est exactement proportionnel au degré de respect qu’il exige.
Manda CISSE