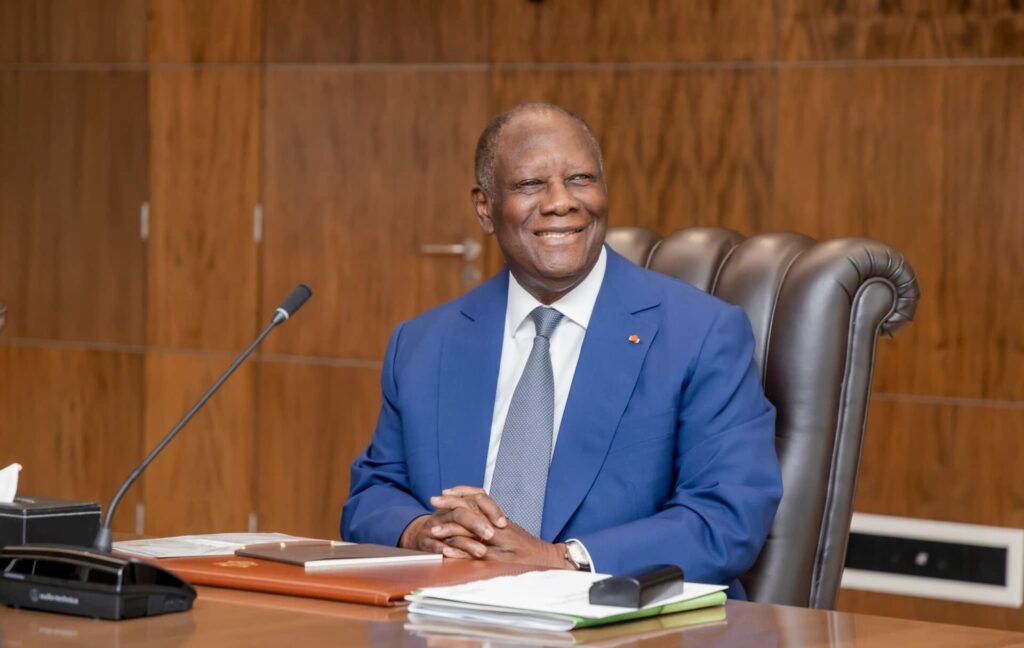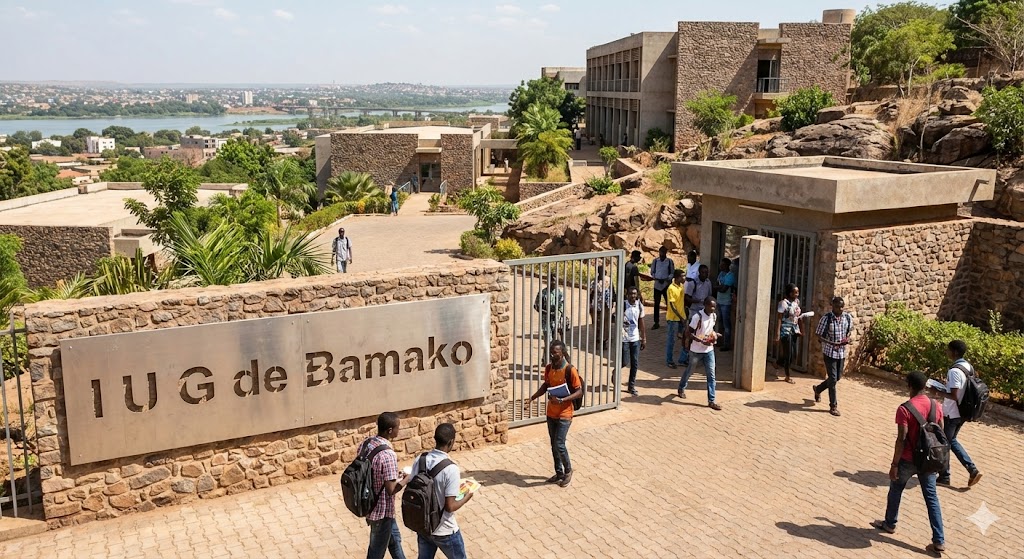Face aux coupes sévères des pays riches dans l’aide publique au développement, des voix s’élèvent pour réclamer une montée en puissance des bailleurs privés dans le financement des pays du Sud. Une solution qui suscite de nombreuses réticences chez les ONG.
Selon l’ONU, qui organise jusqu’à jeudi une conférence sur le financement du développement à Séville, en Espagne, 4.000 milliards de dollars (3.397 milliards d’euros) manquent chaque année pour tenir les objectifs de l’Agenda 2030 en matière de santé, d’éducation ou d’environnement.
Cette situation, qui s’accompagne de lourdes conséquences sociales, pourrait en outre s’aggraver, plusieurs pays ayant annoncé ces derniers mois une baisse de leurs aides, à l’image de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne… et surtout des Etats-Unis.
Ces derniers étaient jusque-là le principal pays donateur pour de nombreuses agences et ONG. Mais la fin de l’agence américaine Usaid, décidée par Donald Trump, a rebattu les cartes et remis l’investissement privé sous les feux des projecteurs.
« Nous avons besoin du secteur privé et des emplois qu’il crée, car les emplois sont le moyen le plus sûr d’en finir avec la pauvreté », a martelé le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, lors de la conférence de Séville.
« Les financements publics à eux seuls ne seront pas suffisants. Mobiliser le capital privé n’est pas seulement une stratégie complémentaire, c’est essentiel », a insisté Christopher MacLennan, chargé du développement international au sein du gouvernement canadien.
– « Pas au bon endroit » –
Dans le document adopté lors de la conférence, destiné à revitaliser l’aide au développement, les pays se sont engagés à générer des fonds « de toutes origines, en reconnaissant les avantages comparatifs des financements publics et privés ».
Une approche défendue par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), qui cherche à accroître les partenariats avec les acteurs privés, mais en faisant en sorte de mieux les orienter vers les besoins réels des pays du Sud.
« Nous avons beaucoup de capitaux privés, mais pas tous alignés sur les priorités nationales (…) Nous savons que l’argent est là, mais il ne va pas au bon endroit », a déclaré à l’AFP le chef du PNUD, Haoliang Xu, en jugeant nécessaire de créer « un environnement propice à l’investissement. »
Pour nombre d’associations et ONG, cette dynamique n’est cependant pas sans danger – les créanciers privés, qui détiennent déjà plus de la moitié de la dette des pays à faible et moyen revenus, étant moins flexibles que les Etats sur les conditions de remboursement de leurs prêts.
Ces acteurs aggravent la crise de la dette « par leur refus de négocier », a ainsi dénoncé Oxfam dans un rapport, en se disant attaché à un développement piloté par les États, jugé plus favorable pour les pays les plus pauvres.
Les pays riches doivent cesser de « s’accrocher à l’espoir illusoire que le secteur privé puisse à lui seul combler le fossé » existant en matière de financement climatique, a mis en garde de son côté Rebecca Thissen, responsable du plaidoyer chez Climate Action Network International.
– « Espoir illusoire » –
Selon l’OCDE, seuls 12% des financements privés mobilisés entre 2018 et 2020 l’ont été dans des pays à faible revenu. Ceux-ci sont généralement considérés comme plus risqués, et poussent les bailleurs à exiger des taux d’intérêt plus élevés, ce qui aggrave la dette des pays concernés.
Pour Laura Carvalho, professeure d’économie à l’Université de Sao Paulo, au Brésil, les financements privés sont souvent perçus par les nations en développement comme une façon de réduire leur « dépendance aux ressources extérieures ».
Mais ils n’ont pas réussi jusqu’ici à se hisser au niveau suffisant pour se substituer aux aides publiques et sont parfois, pour les pays riches, « un moyen de se dérober », assure à l’AFP cette chercheuse, qui pointe en outre, chez les investisseurs, des promesses parfois « fictionnelles ».
Dans ce contexte, le « pouvoir transformateur » des entreprises et des finances privées ne peut être exploité qu’avec une nouvelle architecture financière internationale, a ainsi estimé, lors de la conférence, le président de la Commission de l’Union africaine Mahamoud Ali Youssouf.
Un message relayé par le président kényan William Ruto, qui a exhorté de son côté les États-Unis – absents de la rencontre de Séville – à renoncer à leurs coupes budgétaires: « Le financement public international reste indispensable », a-t-il insisté.
Avec AFP