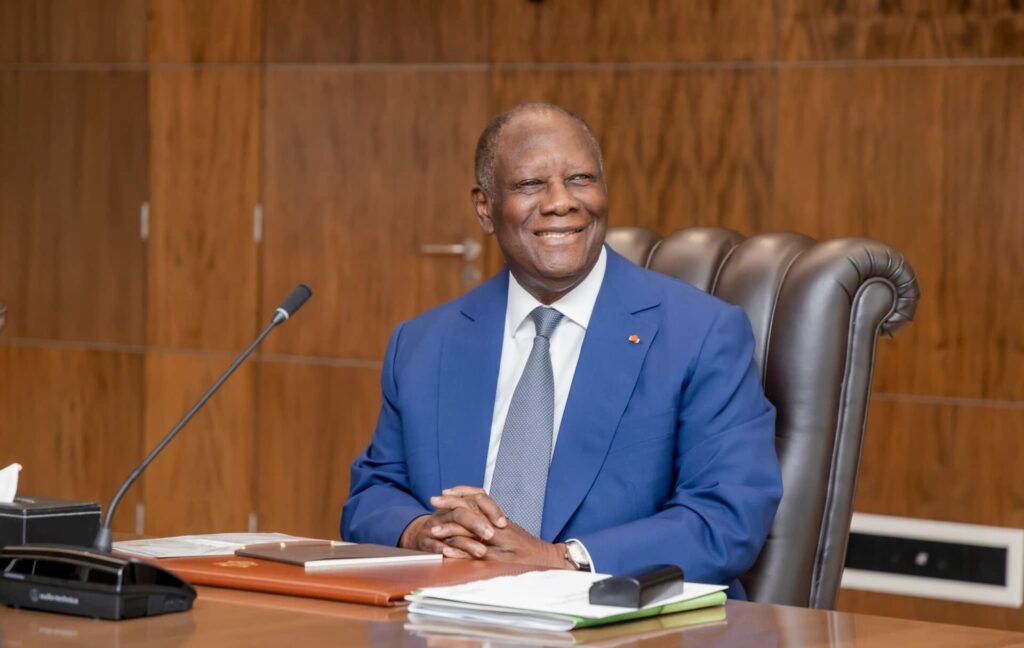Lorsqu’elle a témoigné le mois dernier à propos de l’assassinat de son mari il y a 40 ans, les larmes de Nomonde Calata ont ravivé le souvenir poignant des audiences de la Commission vérité et réconciliation (CVR) en Afrique du Sud dans les années 1990.
De 1996 à 1998, des centaines de victimes et certains des auteurs sont venus devant la CVR livrer le récit glaçant de meurtres, tortures et autres abus commis pendant l’apartheid, dans le but d’exposer les horreurs du régime ségrégationniste et de poser les bases d’une forme de guérison collective.
Internationalement saluée comme un exemple de réconciliation, son bilan fait 30 ans plus tard l’objet de critiques dans le pays, où des voix s’élèvent pour dénoncer le fait que l’exercice a permis à certains d’échapper à la justice.
Nomonde Calata fut l’une des premières à témoigner devant la commission. Alors âgée d’une trentaine d’années, elle avait raconté les assassinats en 1985 par la police de son mari et d’autres militants anti-apartheid connus sous le nom des Quatre de Cradock, l’un des cas les plus emblématiques de cette époque.
Toujours en quête de justice, elle a de nouveau relaté son histoire en juin à la faveur d’une nouvelle procédure, cette fois soutenue par des avocats du programme « Unfinished Business of the TRC » (« Le travail inachevé de la CVR »), de la Fondation pour les droits humains (FHR).
La CVR a reçu environ 7.000 demandes d’amnistie de la part d’auteurs de graves violations des droits humains entre 1960 et 1994, année de l’élection du premier président noir, Nelson Mandela, à la tête du pays.
La commission en a rejeté la plupart, notamment pour six policiers de l’apartheid qui ont confessé leur implication dans les meurtres de Cradock, et a recommandé des poursuites pénales pour 300 cas, notamment lorsque les violences ne poursuivaient pas un objectif politique clair.
Seule une poignée de ces dossiers ont abouti, alimentant les soupçons d’enquêtes délibérément étouffées, y compris par des responsables politiques des gouvernements post-apartheid. Au point que l’actuel président Cyril Ramaphosa a ordonné une nouvelle enquête en mai.
Le temps passe et de nombreux responsables des exactions sont décédés. Mais, explique le directeur exécutif de la FHR, Zaid Kimmiela, « là où des personnes du gouvernement démocratiquement élu après 1994 sont intervenues dans les poursuites pénales, nous espérons que ces personnes seront elles-mêmes poursuivies ».
– « Déni impossible » –
Parmi les quelque 20.000 témoignages écrits soumis à la CVR, plus de 2.000 ont été entendus lors d’audiences télévisées ouvertes au public.
Le processus a exposé la « pleine brutalité » de l’apartheid, ainsi que « certaines vérités très difficiles » sur les groupes anti-apartheid, selon Verne Harris, ancien membre de la commission.
« Son résultat le plus important a été de rendre toute forme de déni impossible — (comme) nier la terreur d’État, nier les unités spéciales mises en place par le régime de l’apartheid pour assassiner les militants, etc », assure-t-il.
La réconciliation nécessitait « de grandes actions symboliques » comme la CVR et un nouvel hymne national, adopté en 1997, souligne M. Harris. « Mais il faut ensuite un travail acharné (…) et c’est là que nous avons échoué de manière si lamentable. »
L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus inégaux au monde et le taux de chômage de plus de 30% affecte de manière disproportionnée les Sud-Africains noirs, tout comme la criminalité et des services publics délabrés.
« Les gens ont commencé par devenir cyniques, puis très en colère. Et donc en ce qui me concerne, le projet de la réconciliation a échoué », conclut M. Harris.
– « Violence structurelle » –
Un dialogue national a été annoncé par Cyril Ramaphosa et doit être lancé en août.
C’est « une revisite » pour faire le bilan et élaborer une feuille de route pour une nouvelle ère, souligne Verne Harris. Mais « le sujet n’est pas celui d’un dialogue national. Le sujet, c’est la volonté politique de réellement mettre en œuvre » les conclusions dudit dialogue.
Le champ d’investigation limité de la CVR, centré sur des actes isolés, n’a pas abordé la « violence structurelle » de la domination blanche, allant de la dépossession des terres aux disparités économiques, souligne Keolebogile Mbebe, maître de conférences à l’Université de Pretoria.
Et l’Afrique du Sud reste aujourd’hui fragmentée, selon elle.
« On continue à dire +les Sud-Africains+ comme si on parlait d’un groupe homogène », poursuit-elle, prenant l’exemple des supporters, venus de tous horizons, de l’équipe nationale de rugby.
« Vous pouvez avoir des supporters des Springboks dans le stade, mais n’oubliez pas: quand le match se termine, tout le monde retourne dans des +pays+ différents. »
Avec AFP